
On l’avait un peu oublié dans les campagnes, mais arbres et productions agricoles ont grand intérêt à vivre ensemble. Au nom de la biodiversité en danger et de la nécessaire transition écologique, l’heure est au retour de l’agroforesterie. S’ils sont aidés, les agriculteurs sont partants !
« Je traite une quinzaine de dossiers par an, mais j’ai 50 demandes en attente ! » constate Florian Carlet. Salarié du GR CIVAM PACA, il est coordinateur Agroforesteries et Agricultures Durables. Planter des arbres au bord des parcelles ou à l’intérieur de celles-ci (on parle d’intra-parcellaire) apporte en effet de nombreux bénéfices. « Une meilleure utilisation des ressources, une plus grande diversité biologique et la création d’un micro-climat favorable à l’augmentation des rendements » affirme le site du ministère de l’Agriculture.
Le profil des agroforestiers
Dans la région, ils sont plutôt jeunes et souvent en bio, sur de petites surfaces, notamment en maraîchage, et en intra-parcellaire. Dans cette filière, les demandes augmentent régulièrement. Moins d’engouement chez les céréaliers, qui font face à des difficultés et ont d’autres priorités. Néanmoins la thématique intéresse, à l’image du projet CLIMAF, coordonné par Arvalis-Institut du Végétal en 2023/2024. Il a permis d’acquérir de nouvelles références en contexte méditerranéen. Les viticulteurs enfin plantent eux aussi de plus en plus de haies et se structurent via les caves coopératives et les syndicats qui les accompagnent.


Les bienfaits de l’agroforesterie
Les études sont nombreuses et concordantes. L’arbre favorise la biodiversité et l’installation d’auxiliaires. Il diminue les dégâts liés au vent, peut réduire l’ensoleillement estival et l’érosion des sols. Il préserve la qualité de l’eau, favorise le stockage du carbone et permet la réduction de l’usage de produits phytosanitaires. En intra-parcellaire, il peut même augmenter les revenus en ajoutant une nouvelle activité de production (fruitiers associés aux légumes, bois d’œuvre associé aux céréales, etc…)
Quand l’État soutient l’agroforesterie
Mais pour porter ses fruits, chaque projet d’agroforesterie doit être bien préparé. Un accompagnement est nécessaire, tant sur le plan technique et agricole, qu’économique. Conscients de l’enjeu, et face au constat de la perte de 23 500 km de haies chaque année entre 2017 et 2021, les pouvoirs publics ont lancé ces dernières années plusieurs dispositifs pour favoriser ses pratiques. En 2020/22 « Plantons des haies ! », en 2023 le « Pacte en faveur de la Haie ». Ce dernier prévoyait un budget de 110 M d’€ chaque année jusqu’en 2030.


Des moyens indispensables pour mettre à la disposition des structures d’accompagnement, des postes de techniciens et financer la formation des agriculteurs, l’achat des plants et souvent les équipements et aménagements nécessaires à la mise en place des projets. Ces dispositifs portés par la DRAAF PACA, peuvent aussi être complétés par d’autres financements de l’Agence de l’Eau ou de l’ADEME. Ils ont emporté l’adhésion de nombreux agriculteurs.
Des moyens bienvenus sur le terrain
D’autant que les acteurs locaux travaillaient déjà à replacer l’arbre au plus près des cultures. Ainsi, depuis 2012, le GR CIVAM PACA dispensait des formations et accompagnait les projets. « Depuis 3 ou 4 ans, on a eu des aides et on a avancé beaucoup plus vite » se réjouit Florian Carlet. Bilan : plusieurs centaines de personnes ont suivi une formation et entre 50 et 66 % sont passées à l’acte.
Plusieurs acteurs se sont structurés pour répondre aux demandes des agriculteurs. Ils ont créé un consortium dans le cadre du Pacte en faveur de la haie. Le GR CIVAM en assure la coordination. Les dossiers sont coordonnés par la DRAAF et instruits par les Directions Départementales des Territoires.


Des financements qui tardent à arriver
Mais l’engouement pour l’agroforesterie semble se heurter aux restrictions budgétaires, et la transition de l’agriculture pourrait être sacrifiée sur l’autel des économies. Pour l’instant, les financements et les dossiers sont gelés, certains postes non pérennisés. Si le Pacte en faveur de la haie a fait émerger de nombreuses demandes, tous espèrent qu’il sera maintenu.
Vers l’agriculture régénérative
Sur le terrain, les recherches avancent et de nouvelles pratiques (parfois fondées sur les anciennes) ouvrent des horizons. Comme l’hydrologie régénérative qui prend en compte tout le système de circulation d’eau sur la parcelle. Elle permet d’optimiser les services rendus au milieu.
Ou encore la régénération naturelle assistée (RNA). Il ne s’agit plus de planter des arbres mais de les laisser venir ! Par exemple en conservant les ronciers. Ils sont « la première étape du retour d’autres végétaux » qui se développeront à l’abri, favoriseront la croissance d’arbustes puis d’arbres et la restauration de la biodiversité.


Autre façon « douce » de les favoriser, l’empilement de bois mort entre des piquets. Des graines s’y déposeront, les végétaux essaieront forcément d’en sortir… L’agriculteur devra simplement dégager un peu le jeune plant pour l’aider à grandir. « Faire en sorte que les ligneux arrivent tout seul » : une méthode qui ne coûte rien, mais réclame évidemment du temps.
Au sein de l’asso Agroforesterie Provence Alpes Méditerranée (APAM), et du GIEE « les hommes qui plantent des arbres », un groupe va se mettre en place pour travailler sur la RNA et se réapproprier d’anciennes pratiques.
Des objectifs pour aller de l’avant
Avec l’élan national, le réseau Bio s’appuie localement sur le GR CIVAM PACA pour se former et sensibiliser d’autres producteurs afin d’accompagner de nouveaux projets. Les groupes sont formés, ont les outils. Tout est prêt. La demande est là. Et si les financements publics promis font défaut, les acteurs se tourneront vers des contributeurs privés. Comme Des Enfants et des Arbres, fondation déjà présente dans la région. Fondations, mécénat, financements privés de la part d’entreprises locales voulant travailler sur leur politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)… On constate un intérêt croissant pour replacer l’arbre au plus près des cultures. Une nécessité face à la hausse des températures.
APAM Agroforesterie Provence Alpes Méditerranée

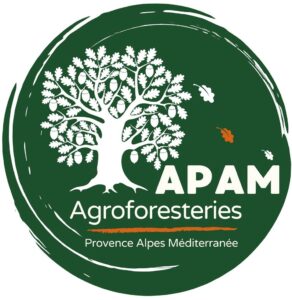
Parmi ses objectifs, favoriser le développement de l’agroforesterie en PACA, faire lien entre les agriculteurs, participer à des projets avec des instituts de recherche, accompagner les agriculteurs sur le plan technique, décliner les politiques publiques et engager le plaidoyer politique.
D’autres acteurs
Réseau Bio – Adear –AD Med APAM – DRAAF -DDT- SAFER PACA – Chambres départementales et régionale d’Agriculture – les PNR – AGROOF (scoop du Gard qui dispense formation et ingénierie de projets.

